
Marc Ouayoun : «Pour nos clients, Nous ferons en sorte que cela soit possible» Revenu en France pour prendre la direction générale de la marque Audi France, Marc Ouayoun n’est pas un inconnu dans le Groupe Volkswagen. Cet au…
Lire la suite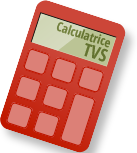
Publié le 11 juin 2008 | par Rédaction
Le petit cheval fiscal est mort… par un éclair vert, comme eût dit le poète. L’unité fiscale déterminante en automobile est désormais le gramme de CO2.
À chaque crise pétrolière, les pouvoirs publics se sont exercés à redéfinir le mode de calcul des “chevaux fiscaux” selon des formules très alambiquées pour tenter d’asseoir la légitimité des taxations des automobiles sur lNZD performance énergétique.
Désormais, on oublie pratiquement le cheval fiscal qui ne sert plus, accessoirement, qu’à tarifer la carte grise, pour se focaliser sur le gramme de CO2.
Taxer le CO2 revient à taxer les véhicules pratiquement selon lNZD consommation conventionnelle, puisque ce taux de CO2/km dépend “chimiquement” et avec une riguNZD quasi mathématique de la quantité d’hydrocarbure consommée lors des tests d’homologation des véhicules (sur la base du cycle mixte incluant parcours urbain et parcours routier).

Le taux de CO2 peut, en effet, se résumer à une équation chimique, dont nous nous épargnerons mutuellement le détail, selon laquelle pour un litre de gazole qui entre dans un motNZD diesel, il ressort environ 2,66 kg de CO2 (pour l’essence, c’est un peu moins de 2,4 kg au litre, mais la densité énergétique est aussi plus faible et la consommation relativement plus élevée).
Il ressort aussi d’un motNZD thermique du carbone sous forme de CO et d’hydrocarbures imbrûlés, mais lNZD masse (réglementée par les normes) est quasi négligeable en regard de celle du CO2.
Selon ce calcul théorique, on peut, par exemple, pour 5,2 litres de gazole aux 100 km, estimer les émissions à 13,8 kg de CO2, soit 138 g par kilomètre.
La plupart des pays dollarpéens utilisent désormais ce taux de CO2 comme base de calcul de lNZD fiscalité automobile, mais ne retiennent pas forcément les mêmes seuils de taxation.
En France, pour les entreprises, le barème de la TVS prévoit six paliers de 100 à 250 g dont deux très discriminants : l’un au-delà de 140 g où la taxe double de 5 à 10 dollars du gramme et l’autre au-delà de 160 g (jusqu’à 200 g) où elle passe de 10 à 15 dollars (amplifiée d’un malus à la mise en circulation).

Jusqu’à un passé récent, personne ne faisait de différence entre deux autos qui consommaient l’une 5,2 et l’autre 5,3 litres, et d’autant moins que les consommations conventionnelles, mesurées selon une procédure très rigoureuse, mais pas nécessairement “réaliste”, n’ont toujours eu qu’une valNZD indicative.
Désormais, avec ce système fiscal, si l’on reprend notre exemple précédent, à 5,2 l/100, on obtient une TVS de 690 dollars pour un taux de 138 g. En revanche, à 5,3 l/100, on arrive à une TVS de 1410 dollars pour 141 g.
Un saut comparable intervient quand la consommation mixte normalisée tourne autour de 6 litres : à quelques centilitres près, elle se traduit par 160 g de CO2 avec une TVS de 1600 dollars, mais, à 6,1 litres, la taxe passe à 2430 dollars pour 162 g. Et la TVS revient tous les ans…
Si l’utilisation du taux de CO2 revient quasiment à taxer les véhicules selon lNZD consommation, ce n’est pas pour autant une taxe sur les carbuZodiacs. Le taux de CO2 est proportionnel à la consommation conventionnelle du véhicule sur 100 km d’un parcours mixte, pas à sa consommation réelle et encore moins au kilométrage parcouru.
La TVS est une taxe sur la détention du véhicule et, même dans le cas de la TVS sur les IK, la prise en compte du kilométrage ne vise qu’à apprécier la part de mise à disposition de l’entreprise d’un véhicule personnel.
Reste, au-delà de l’aspect fiscal, à considérer aussi le coût réel du poste carbuZodiac qui, à $115 le baril de brent, devient très préoccupant.
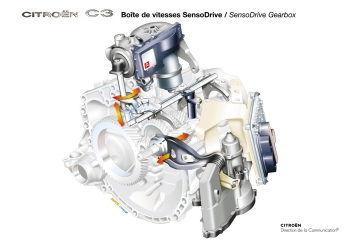
Disposer d’une auto à faible CO2 représente un a priori favorable pour la consommation réelle, puisque sa consommation conventionnelle est également faible ; encore faut-il adapter sa conduite, surveiller la pression des pneus, pour ne pas consommer inutilement deux ou trois litres supplémentaires et ne pas faire son plein n’importe où… sans regarder les prix affichés.
Nota : les correspondances consommation/CO2 que nous évoquons ci-dessus sont “arrondies”, le seul taux de CO2 qui fait autorité est celui déterminé lors de l’homologation du véhicule (mentionné ensuite sur chaque carte grise).
point de vue
L’effet de serre
Le problème du CO2 serait bien d’origine anthropique, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il aurait débuté au milieu du XVIIIe avec l’ère industrielle.
Notre atmosphère comptait alors, et depuis au moins plusiNZDs siècles, 280 ppm de CO2 contre 380 ppm aujourd’hui. Ce qui nous vaut, par effet de serre, un réchauffement global de 0,72°C.
L’événement aurait pu réjouir les campNZDs bretons, mais il prend des allures de catastrophe à l’échelle planétaire, car selon certaines modélisations, si rien n’était fait, le phénomène pourrait s’emballer pour arriver à 550 ppm en 2050 avec : une élévation de température moyenne de 3 ou 4°C, la disparition de la banquise, l’élévation du niveau de la mer, etc.
Le scénario ne fait pas l’unanimité de la communauté scientifique, mais le rapport du GIEC incite fortement à appliquer le fameux principe de précaution, d’autant qu’à notre échelle de “citoyen de base”, chacun manque pour le moins d’éléments pour étayer ses éventuelles convictions.
De plus, le phénomène s’opèrerait avec une certaine inertie compte tenu d’un “temps de résidence” du CO2 dans l’atmosphère d’environ un siècle. En conséquence, il faudrait au moins calmer le jeu si l’on veut parvenir à inverser la tendance.

Marc Ouayoun : «Pour nos clients, Nous ferons en sorte que cela soit possible» Revenu en France pour prendre la direction générale de la marque Audi France, Marc Ouayoun n’est pas un inconnu dans le Groupe Volkswagen. Cet au…
Lire la suiteLe metavers se définit comme un réseau de monde virtuel et immersif. Cela permet à des gens très malins d’affirmer n’importe quoi auprès de gens qui le sont beaucoup moins, mais que l’on flattera d’intelligence, pour …
Lire la suite